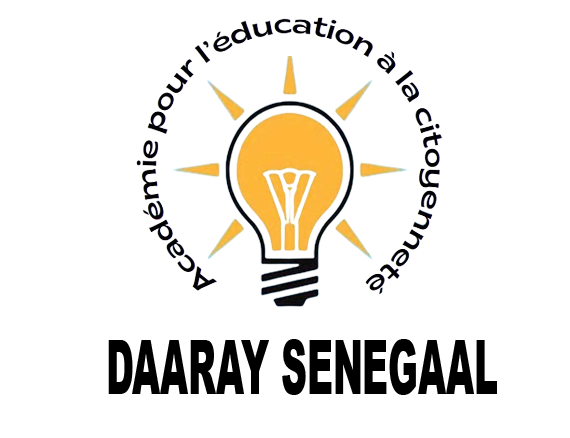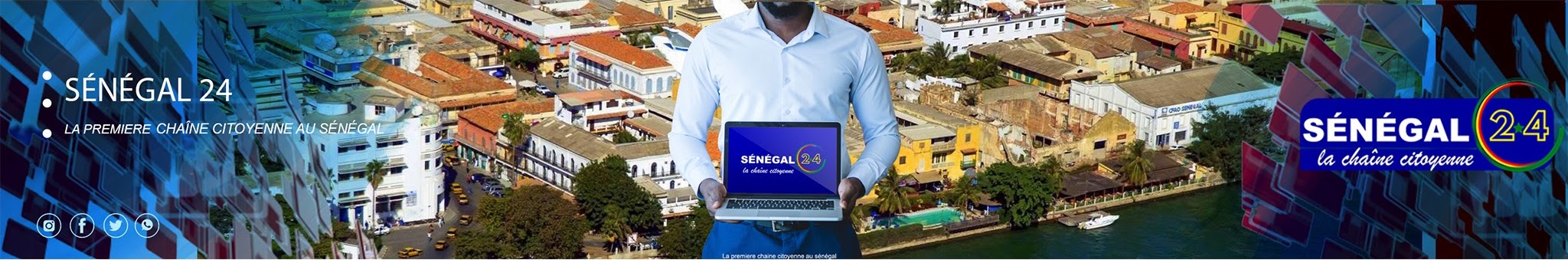Indépendance de la justice, confiscation des libertés, mauvais traitements des enfants : les griefs de la RADDHO

La Rencontre africaine des droits de l’homme (Raddho) a partagé ses inquiétudes en matière de démocratie, des droits et des libertés fondamentales au Sénégal. L’organisation non gouvernementale ayant Statut spécial à l’ECOSOC aux Nations Unies remettait son rapport alternatif à l’attention de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur la situation au Sénégal. Il ressort de ce document un net recul démocratique marqué par les restrictions des libertés de réunion pacifique et d’association et d’expression et les cas de torture et autres mauvais traitements notés surtout envers les enfants. Une note salée pour le Gouvernement du Sénégal qui, à la même période présentait son rapport annuel par visioconférence sur la situation des droits humains du Sénégal.
Le Sénégal est loin du compte en matière de démocratie et du respect des droits et des libertés fondamentales. C’est le constat amer noté par la Rencontre africaine des droits de l’homme (Raddho). L’ong au statut de membre observateur à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) de l’Union Africaine a porté ses griefs au niveau de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples basée à Banjul, en Gambie. Selon la Raddho, « la situation des droits humains au Sénégal est marquée depuis quelques années par une restriction des droits civils et politiques notamment les droits électoraux et les droits à la liberté d’opinion et d’expression ».
L’organisation de défense des droits de l’homme convoque les tristes évènements de mars 2021 avec son lot de victimes, quatorze morts enregistrés selon les chiffres officiels, les manifestations de juillet 2022 à Dakar et dans la région de Ziguinchor qui ont couté la vie à deux personnes.
Textes biaisés
S’agissant de la liberté d’expression, la Raddho considère que l’Etat du Sénégal biaise les textes et instruments garantissant les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs.
Omar Niasse et Cie estiment que « plusieurs personnes ont été arrêtées et poursuivies sur la base de charges telles que l’offense au Chef de l’Etat, outrage à magistrat, injures publiques, diffusion de fausses nouvelles, diffusion d’informations portant sur le secret défense, les actes et manœuvres mettant en danger la sécurité de l’Etat ou jetant le discrédit sur les institutions, ou même participation à une manifestation interdite etc ». Pour eux, « ces personnes ne faisaient qu’exercer leurs droits à la liberté d’expression ».
Libertés d’expression menacées
Le rapport renchérit de plus belle par la traque dont font l’objet certaines personnes. « Les libertés d’expressions sont menacées au Sénégal car les journalistes, les activistes, les participants à des manifestations et les opposants au régime sont poursuivis, persécutés, convoqués à la police et souvent emprisonnés », lit-on dans ledit document.
Une situation qui maintient toujours le Sénégal dans la lanterne rouge en matière de démocratie alors qu’il s’est engagé auprès des instances internationales à travers la ratification des traités et instruments juridiques à promouvoir les libertés et droits fondamentaux.
Incohérences décelées
L’ong a aussi décelé des incohérences dans le fonctionnement de la justice qui sapent le principe de l’indépendance de ce troisième pouvoir. « La question de l’indépendance de la justice reste entière car le statut des magistrats contient des dispositions discriminatoires avec des dates de départ à la retraite différentes qui ne dépendent que du poste occupé par le magistrat. Il s’y ajoute les consultations à domicile qui ne sont rien d’autre qu’un moyen de contourner le passage prévu légalement au niveau du Conseil supérieur de la Magistrature », note la Raddho. «
S’agissant du secteur de la justice, les « droits de l’hommiste » regrettent le fait que « malgré les nombreuses critiques émanant des justiciables et des acteurs de la Justice, le Sénégal ne semble pas être disposé à rendre le Parquet indépendant de la Chancellerie ». En outre, dans son organisation et son fonctionnement, l’Ong juge le personnel judicaire trop insuffisant par rapport au nombre de justiciables pris sur tout le territoire national. En effet, d’après les statistiques de Juin 2019, le Sénégal ne dispose que de 546 magistrats, 121 procureurs aussi appelés magistrats du parquet et 425 juges.